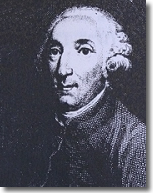
(Charles) Georges Leroy,
Lettres sur les animaux, Lettres IV,
The Voltaire foundation, At the taylor institution, Oxford, 1994, p.102-107.
Bibliothèque virtuelle
des droits des animaux
Sur la perfectibilité des animaux
Nous avons reconnu, Monsieur, en parcourant la vie journalière de quelques animaux qu'ils sont doués de la sensibilité et de la mémoire, de la faculté de saisir des rapports et de juger, du pouvoir de réfléchir sur leurs actes, etc., nous ne pouvons pas douter que l'usage de ces facultés ne s'applique à plus ou moins d'objets, en raison des occasions et des besoins. Nous sommes forcés d'avouer qu'on ne peut pas fixer la mesure de l'intelligence des différentes espèces de bêtes, puisqu'elle dépend des circonstances, qu'elle s'étend toujours lorsqu'elle est mise en action par la nécessité, et qu'elle ne se resserre, que par le défaut d'exercice.
D'après ces faits incontestables, il semble qu'on devrait remarquer dans les bêtes quelques progrès généraux d'intelligence. La perfectibilité, attribut nécessaire de tout être qui a des sens et de la mémoire, devrait se développer lorsque les circonstances sont favorables, et par degrés élever quelques espèces à un état supérieur. On les verrait alors policées dans un lieu, plus ou moins sauvages dans un autre, montrer dans les moeurs des différences marquées: c'est ce que nous n'apercevons pas. Si l'on n'était pas forcé d'ailleurs d'admettre dans les bêtes la faculté de se perfectionner, l'inutilité constante dont elle paraît, ferait presque douter de son existence ; mais en y réfléchissant un peu, il est aisé de sentir d'abord que nous ne sommes pas juges compétents des progrès de ces êtres, si différents de nous à beaucoup d'égards, et qu'ils pourraient en avoir fait de fort étendus, sans qu'il nous fût possible de les apercevoir. Nous pouvons nous assurer ensuite que le pouvoir naturel de se perfectionner, doit être aidé de tant de conditions et de moyens extérieurs que les bêtes ne réunissent point, qu'avec la qualité d'êtres perfectibles elles ne doivent pas en effet se perfectionner beaucoup. Que nous ne soyons pas juges compétents des progrès des bêtes, cela me paraît incontestable. En voyant quelques-unes de leurs actions, nous observons quel chemin leur intelligence a dû parcourir pour arriver à la détermination qui les produit. Nous distinguons ce qui appartient à la perception simple, au jugement, à la réflexion, etc. Nous pouvons démêler quelques-uns de leurs desseins, pénétrer dans les motifs qui déterminent leurs mouvements décidés, parce que ces motifs sont les causes essentielles et nécessaires des mouvements que nous apercevons. Mais si nous voyons clairement l'intention de l'hirondelle lorsqu'elle travaille à construire son nid, nous ne pouvons pas savoir si le teins n'a pas perfectionné son architecture, si l'expérience n'ajoute pas de l'élégance ou de la commodité à cette construction. Nous n'avons pas les moyens de juger de ce qui est grâce ou commodité pour elle. En général, dans tous ces ouvrages qui ont un objet commun et qui nous sont aussi peu familiers, nous ne pouvons être frappés que d'une ressemblance grossière qui nous fait conclure l'uniformité absolue.
Il est vraisemblable que les bêtes n'aperçoivent non plus aucune différence entre nos palais et nos chaumières ; que l'aigle ne distingue pas, dans les mouvements des différents peuples sur lesquels il plane, les degrés de police auxquels ils peuvent être parvenus. Une horde de sauvages errants autour de ses cabanes, et une troupe de savants dans une ville bien bâtie, doivent lui paraître également des êtres qui marchent sur leurs pieds, et qui s'agitent à peu-près de la même manière. Il est impossible même qu'en observant la plupart des espèces de bêtes, nous jugions de tous les progrès particuliers qu'ont pu faire quelques individus. Les principaux instruments des idées qu'elles acquièrent sont précisément ceux auxquels nous devons nous-mêmes le moins d'idées. Nous ne pouvons donc pas connaître les éléments qui entrent pour elles dans la composition de toute idée complexe, parce que nous n'avons pas au même degré les sensations prédominantes dont elle est composée. Delà il doit résulter une entière différence entre le système total de leurs connaissances et celui des nôtres. Par exemple, les idées acquises par l'odorat n'influent presque en rien sur nos habitudes ni sur nos progrès. Mais si nous considérons ce sens tel qu'il est pour les animaux carnassiers, c'est-à-dire comme un organe principal,' comme un toucher très-fin qui les instruit, à de grandes distances, des rapports que les objets peuvent avoir avec leur conservation, nous verrons qu'il nous est impossible d'atteindre à toutes les connaissances que ces animaux peuvent acquérir par le secours de leur nez. Si nous décidons de l'ensemble de celles de leurs idées dans lesquelles la sensation de l'odorat entre comme élément principal, nous tomberons dans le cas d'un aveugle qui voudrait juger des progrès de la peinture.
Il est donc certain que les bêtes pourraient avoir fait des progrès, sans que nous fussions capables de les sentir ; mais il est vraisemblable qu'elles n'en ont pas fait beaucoup, et même qu'elles n'en feront jamais. Elles manquent, et d'un intérêt assez actif, et de quelques-unes des conditions sans lesquelles il paraît impossible que la perfectibilité ne reste pas inutile.
Premièrement, les animaux n'ont pointa d'intérêt à faire des progrès. Nous avons vu, Monsieur, dans les lettres précédentes, que leur manière de vivre habituelle consiste dans la répétition d'un petit nombre d'actes fort simples qui suffisent à tous leurs besoins. Ceux dont le penchant à la rapine tient l'industrie éveillée, ou que des dangers multipliés forcent à une attention presque continuelle, acquièrent à la vérité des connaissances plus étendues que les autres ; mais, comme ils ne vivent point en société, cette science presque individuelle, ne se transmet du moins qu'à un petit nombre dans l'espèce. Ils sont forcés d'ailleurs de partager leur vie entre l'agitation et le sommeil. Les animaux qui paraissent vivre en société, ou sont rassemblés par la crainte, sentiment peu fécond en progrès, ou n'ont qu'une société passagère, ou ne sont d'aucune utilité les uns aux autres pour la recherche des besoins de la vie ; ou bien, mis sans cesse en péril par l'homme, ils n'ont qu'une association précaire, toujours troublée ou prête à l'être, et qui ne peut comporter de projet que celui d'agir ensemble dans l'instant, sans rien méditer pour l'avenir. De ce que nous ne voyons pas faire aux bêtes des progrès sensibles, il faut donc se garder de conclure qu'elles ne sont pas douées de la perfectibilité. Un homme qui serait né sans yeux et sans mains, aurait au-dedans de lui le pouvoir d'acquérir de nouvelles idées sans en avoir les moyens extérieurs. Même avec le secours de tous leurs sens, les hommes continuellement occupés à pourvoir à leurs besoins de première nécessité, restent dans le cercle étroit des connaissances qui y sont immédiatement relatives. Ils n'acquièrent qu'un nombre d'idées plus borné que n'en paraissent avoir quelques individus dans certaines espèces d'animaux.
Il est nécessaire que beaucoup de conditions servent la perfectibilité ; et sans elles, les êtres qui auraient les plus grands progrès en puissance, ne les réaliseraient jamais. La société, le loisir, les passions factices qui naissent de l'un et de l'autre, l'ennui, qui est un produit des passions et du loisir, le langage, l'écriture qui suppose l'usage des mains, sont autant de moyens nécessaires, sans lesquels on ne doit pas attendre de progrès sensibles de la part des êtres les plus intelligents. Or, il faut voir si les bêtes ont toutes ces conditions, et de quelle importance sont celles dont elles pourraient manquer.
Il y a sans doute plusieurs espèces qui paraissent vivre en société ; mais, en examinant le caractère de leur association, il est aisé de voir qu'elle ne peut pas être féconde en progrès. Tous les frugivores qui vivent ainsi, paraissent rassemblés uniquement par la frayeur qui les oblige à se tenir près les uns des autres pour se rassurer un peu. Mais le sentiment commun qui les réunit n'établit entre eux aucun rapport actif d'utilité réciproque, même relativement à son objet. S'ils craignent moins lorsqu'ils sont ensemble, ils n'en sont pas plus redoutables à leurs ennemis. Un chien seul disperse cette timide association, dont l'union ne peut pas augmenter les forces. Les autres détails de leur vie tendent à dissoudre plutôt qu'à resserrer la liaison qui pourrait se former entre eux. Ils broutent ensemble l'herbe qui leur est nécessaire à tous. Cette action simple peut produire une rivalité dans le cas de disette, et ne peut jamais amener un secours mutuel. Un cerf ne peut rien attendre de son voisin, et il peut craindre qu'il ne lui enlève la moitié de sa nourriture. Il n'y a donc pas de société proprement dite entre ces animaux. Ceux mêmes qui paraissent se tenir unis par le projet de la défense commune, et auxquels le secours mutuel de leurs forces et de leur courage fait sentir l'avantage de la société, les sangliers, par exemple, sentent aussi combien pour se nourrir aisément il est désavantageux d'être en troupe. Dès que les mâles ont atteint l'âge de trois ans, et que leurs défenses ayant pris leur accroissement, les mettent dans le cas de compter sur leurs forces, ils se séparent et vivent seuls: on ne voit en troupe que les femelles, qui sont moins heureusement armées, avec les jeunes mâles. Les lapins vivent en société ; mais si ces animaux faibles et timides acquièrent, quant à leur sûreté, toutes les connaissances qu'ils peuvent obtenir de leur organisation, ils sont dominés par une inquiétude continuelle, trop occupante pour laisser beaucoup de teins à la réflexion. Cependant, si nous pénétrons dans l'intérieur de leurs habitations, nous pouvons remarquer l'art de la distribution dans leurs logements, et un ensemble de précautions qui les mettent à l'abri des accidents qui les menacent. Les terriers sont ordinairement placés de manière à n'être pas exposés aux inondations: l'entrée masque en partie l'intérieur du domicile ; la multiplicité des chambres qui se communiquent, et les détours des corridors, lassent et rebutent souvent le furet qui pénètre dans la demeure. Le lapin, assez instruit pour préférer de se laisser tourmenter dans son terrier, au péril qu'il courrait à en sortir, trouve un asile presque assuré dans ce labyrinthe. Mais d'ailleurs ces animaux, forcés de brouter l'herbe où elle se trouve, ne peuvent être d'aucune utilité les uns aux autres, quant à la recherche des besoins de la vie.
Les animaux carnassiers ne vivent guère en société: leur voracité naturelle et la disette de proie les obligent de s'éloigner les uns des autres. Deux louves, deux oiseaux de proie, ne s'établissent avec leur famille qu'à une certaine distance, proportionnée à l'étendue de pays qui leur est nécessaire pour subsister. Loin de vivre en société, lorsqu'il y a concurrence et rencontre, il s'en suit presque toujours un combat, à la fin duquel le plus faible est forcé de s'éloigner.
Il y a quelques espèces d'animaux, que leur organisation et leur instinct portent à travailler ensemble au bien commun: tels sont les castors. Il est impossible de prévoir sûrement à quel degré s'élèverait leur intelligence, si on les laissait se multiplier tranquillement et jouir des résultats de leur association. Mais ce malheureux avantage qu'ils ont d'être utiles à l'homme fait qu'on a songé beaucoup plus à les chasser qu'à les observer. A peine leur laisse-t-on commencer quelques habitations qu'elles sont bientôt démembrées. Ils n'ont point de loisir, puisqu'ils sont continuellement occupés d'une crainte qui ne laisse aucun exercice à la curiosité.
Il ne suffit pas que des animaux vivent rassemblés, pour qu'ils aient une société proprement dite et féconde en progrès. Ceux mêmes qui paraissent se réunir par une sorte d'attrait, et goûter quelque plaisir à vivre les uns près des autres, n'ont point la condition essentielle de la société, s'ils ne sont pas organisés de manière à se servir réciproquement pour les besoins journaliers de la vie. C'est l'échange des secours, qui établit les rapports qui constituent la société proprement dite. Il faut que ces rapports soient fondés` sur différentes fonctions qui concourent au bien commun de l'association, et dont le partage rende, à chacun des individus, la vie plus facile, aille à l'épargne du teins et produise par conséquent du loisir pour tous ; alors l'utilité générale des offices que les individus ont choisis, devient une mesure commune de leur mérite. L'émulation s'établit par l'habitude qu'ils prennent de se comparer entre eux, et elle enfante des efforts. Ceux qui se sentent trop faibles pour être, veulent du moins paraître ; et là commence le règne des passions factices, qui sont le produit de la société et du loisir.
Les bêtes n'ayant, comme nous l'avons vu, ni société proprement dite, ni loisir, n'ont point de passions factices ; elles n'ont point de ces besoins de convention, qui deviennent aussi pressants que les besoins naturels, Isatis pouvoir être satisfaits comme eux, et qui, par cela même, tiennent l'intérêt, l'attention, et l'activité des individus, dans un exercice continuel. La nécessité d'être émus ; d'être vivement avertis de notre existence, qui se fait sentir en nous dans l'état de veille et d'inaction, est en grande partie la cause de nos malheurs, de nos crimes et de nos progrès. C'est un besoin toujours agissant, qui s'irrite par les secours même qu'on lui donne, parce que le souvenir d'une émotion forte rend insipides la plupart de celles qui n'ont pas le même degré de force. De-là cette ardeur à chercher toutes les scènes de mouvement, tous les genres de spectacles d'où peut résulter une impression attachante et vive ; de-là aussi ce malaise de curiosité qui nous force à chercher au-dedans de nous-mêmes, par la méditation, une occupation qui nous intéresse. Les bêtes ne connaissent point cet état qui fait le tourment de l'homme oisif et policé. Elles ne sont excitées à l'attention que par les besoins de l'appétit, ceux de l'amour, et la nécessité d'éviter le péril. Ces trois objets occupent la plus grande partie de leur teins, et elles passent le reste dans un état de demisommeil, qui ne, comporte ni l'ennui, ni la curiosité stimulante que nous éprouvons. Les moyens qu'elles ont pour se procurer leur nourriture et pour échapper au danger, sont bornés par leur organisation. II leur serait impossible d'en inventer d'autres, parce que les moyens de fabriquer des instruments leur sont interdits par la Nature: elles n'ont de ressource que dans leur industrie et dans leurs armes naturelles ; et nous avons vu que quand elles sont excitées et instruites par les circonstances et les difficultés, l'homme du plus grand génie n'aurait rien à leur apprendre. D'ailleurs, les bêtes sont naturellement vêtues ; et ce premier besoin de l'homme doit avoir été, dans l'origine, le motif intéressant qui l'a excité à beaucoup de recherches. Les peuples qui peuvent se passer d'habits, sont en général plus stupides que les autres, parce qu'ils manquent d'un besoin qui devient bientôt la source d'un grand nombre d'inventions et d'arts.
Je m'arrêterai ici, et je me réserve de vous parler, dans une autre lettre, de l'influence de l'amour sur la perfectibilité des animaux..